Comprendre le crowdequity : guide complet sur le financement participatif en actions

En bref : le crowdequity, c’est quoi ? 🚀 Voici l’essentiel à retenir si vous êtes pressé : Le crowdequity (ou crowd equity, equity crowdfunding) permet à n’importe qui d’investir dans le capital de startups ou PME non cotées. En échange de votre mise, vous recevez des parts de l’entreprise : vous devenez actionnaire, avec tout ce que ça implique (droits, risques, perspectives réelles de rendement ou de perte). Ce type de financement participatif en actions apporte des fonds propres aux jeunes entreprises qui cherchent à décoller, sans passer par la Bourse ni les réseaux de business angels classiques. Accessible via des plateformes spécialisées (ex: WiSEED, Anaxago, Tudigo, Finple…), il se distingue clairement du crowdfunding en don, crowdlending (prêt) ou don avec contrepartie. Investir, c’est aussi s’engager ! Le crowdequity engage les investisseurs sur le moyen terme… C’est du vrai capital. Les risques ? Modérés ou élevés, mais les perspectives ? Parfois explosives ! Pour aller plus loin sur le montage entrepreneurial, vous pouvez jeter un œil à mon article sur la assemblee generale quorum ou comparer d’autres montages de financement (credit bail avantages et inconvenients par exemple). Voilà, le pitch est posé. Mais au fond… pourquoi miser sur le crowdequity ? Comment ça fonctionne en coulisses ? Où investir sans tomber dans le panneau ? Je vous dis tout, sans filtre. C’est parti – et si on allait au cœur du système ? Qu’est-ce que le crowdequity ? Définition du crowdequity (crowd equity, equity crowdfunding) Alors, le crowdequity, c’est quoi exactement ? On entend tout et n’importe quoi. Certains l’appellent equity crowdfunding, d’autres crowd equity… ou tout bêtement financement participatif en actions. À la base, l’idée est franchement simple : regrouper des petites (ou grosses) mises d’investisseurs particuliers ou professionnels, et les injecter directement dans le capital d’une entreprise non cotée. Ce n’est pas du don, non. Ce n’est pas un prêt non plus. Ici, vous recevez des parts, des actions. Vous devenez actionnaire – aucun doute là-dessus. Si la boîte cartonne ? Vous touchez une part des plus-values lors d’une revente (ou via dividendes si la boîte décolle vraiment). L’entreprise a besoin de fonds propres pour avancer, innover, embaucher ? Le crowdequity est là. Vous me direz : « OK, mais ça change quoi d’investir par ce biais ? » Franchement : le crowdequity démocratise l’investissement en private equity, avant réservé aux gros poissons (fonds, business angels). Aujourd’hui, il suffit d’un clic – et parfois… d’une bonne dose d’audace. Envie d’aller plus loin sur la gestion financière ? Pensez à regarder mon analyse sur le retours sur investissement. C’est ultra-complémentaire ! Crowdequity vs autres formes de crowdfunding : les 4 grandes familles Parlons vrai. Le financement participatif, c’est un océan. Je m’y suis moi-même perdu au début, croyez-moi ! Pour y voir clair, il faut bien distinguer les 4 types de crowdfunding principaux : Le don simple : vous donnez, point barre (aucune contrepartie, c’est du mécénat pur) Le don contre récompense : vous recevez un cadeau, ou un produit en avant-première (le modèle de Kickstarter… tout le monde connaît !) Le crowdlending (prêt participatif) : vous prêtez de l’argent, et touchez des intérêts en retour (le côté banquier, en somme) Le crowdequity (crowd equity) : vous investissez, et obtenez des parts du capital. Le vrai pari, avec tous ses enjeux et ses promesses ! La différence majeure ? Avec le crowdequity, il ne s’agit pas de philanthropie ni d’un placement garanti. Vous jouez – un peu – au capital risque, mais en version collective et accessible. Ça explose ou ça capote… Voilà la réalité : tout n’est pas rose, mais quel frisson ! Comment fonctionne le crowdequity ? Le processus d’investissement en crowdequity Je vais être franc : la première fois que j’ai voulu investir via une plateforme de crowd equity, je m’attendais à un parcours du combattant. Surprise, c’est presque « plug-and-play » : Vous choisissez votre plateforme de crowdequity. (WiSEED, Tudigo, Anaxago… j’en cause plus bas !) Vous analysez les projets ouverts à l’investissement – business plan, équipe, secteur… tout est affiché. Vous créez un compte vérifié, injectez vos fonds (souvent dès 100 ou 200 €), confirmez votre souscription. La levée de fonds se clôture, la société lève les capitaux nécessaires. Vous recevez vos actions/parts, que vous gardez plusieurs années (exit possible lors d’un rachat, une vente, une IPO… mais ce n’est jamais garanti !). Si la boîte réussit, vous profitez de sa croissance (plus-value, dividendes, fierté perso). En cas d’échec… la perte est possible. C’est ultra-transparent, mais attention : il faut avoir un minimum de temps à consacrer à l’étude des projets. Je me suis déjà emballé sur une start-up trop belle… qui a calé au bout de deux ans. Il vaut mieux diversifier, sérieux. Pour ceux qui hésitent avec d’autres formes de financement, voyez mon article comparatif sur le credit bail avantages et inconvenients, la logique du risque/rendement est radicalement différente. Qui peut investir dans le crowdequity ? Bonne question… et c’est LA grande force du financement participatif en actions aujourd’hui. Le crowdequity en France est ouvert à tous : Les particuliers (même débutants, même petits budgets !) Les chefs d’entreprise et investisseurs aguerris Les sociétés (parfois les holdings, SCI, etc.) Aucun besoin d’être un pro de l’investissement ou de détenir un gros portefeuille. Certains sites fixent un ticket d’entrée minimal, mais j’ai vu passer des campagnes où 100 € suffisaient. A contrario, plusieurs plateformes imposent un plafond ou des critères pour protéger les non-professionnels. C’est une bonne chose – croyez-moi, il vaut mieux y aller tranquille au début… D’ailleurs, si vous voulez jongler entre différents statuts, la réflexion sur le choix entre auto entrepreneur ou sasu peux aussi avoir son importance selon l’objectif d’investissement. Les avantages et risques du crowdequity Pourquoi choisir le crowdequity comme source d’investissement ? Vous me demandez : « Ok, mais quels avantages ? Pourquoi pas du PEL, de la pierre, un ETF…? » Franchement, il n’y a pas photo côté émotion. Mais le crowdequity, ce n’est pas que pour vibrer… Accès direct à l’innovation : vous soutenez – et accompagnez – la croissance de jeunes entreprises françaises, souvent
Comprendre la matrice SEPO : définition, utilité et méthode

🗂️ En bref : la matrice SEPO résumée en 5 points Outil d’auto-évaluation participatif : la matrice SEPO analyse Succès, Échecs, Potentialités, Obstacles. Très pratique pour équipes et gestion de projets – bilan et anticipation des actions. Vision à la fois rétrospective et prospective (passé/futur). S’appuie sur la co-construction et l’échange collectif. Permet un bilan structuré, simples à animer, facile à adopter même pour les novices. Voilà, déjà, vous avez une grille de lecture. Un outil qui s’utilise simplement et qui peut, franchement, changer l’ambiance d’une séance de bilan-projet… Si jamais vous bossez dans les RH, l’innovation ou la gestion d’équipe, votre curiosité sur les autres approches, genre la methode osbd ou le deming cycle, se réveillera sûrement à la lecture de cet article. La matrice SEPO : qu’est-ce que c’est et quels sont ses objectifs ? Bon. Ce que j’ai remarqué : souvent, en entreprise, on s’attarde sur les résultats sans jamais vraiment comprendre pourquoi on trébuche ou sur quoi on peut capitaliser. La matrice SEPO vient justement combler ce vide. C’est un outil d’auto-évaluation SEPO, participatif, format tableau/croix, qui invite une équipe à s’arrêter pour réfléchir sur son parcours. Elle se concentre sur 4 axes : Succès, Échecs, Potentialités, Obstacles. Elle fonctionne en atelier : chacun donne sa perception, met en commun… et l’on avance ensemble. On fait le point sur ce qui a marché et ce qui bloque, mais surtout : ce qu’on va exploiter demain. Que ce soit pour piloter une équipe, faire un bilan projet participatif ou même encadrer des nouveaux membres, je trouve cet outil hyper fédérateur. On pose enfin les mots sur ce qui a VRAIMENT fonctionné et ce qu’on laisse en plan, en évitant la langue de bois. Les 4 axes de la matrice SEPO expliqués en détail Je vais détailler ces axes. Vous allez voir, c’est hyper visuel, facile à saisir : Succès (S) Ce qu’on a réussi, les points forts et les « bonnes surprises » factuelles. Échecs (E) Ce qui n’a pas fonctionné, les ratés, les leçons à tirer (sans flagellation inutile, juste factuel). Potentialités (P) Les opportunités, pistes d’amélioration, axes à développer pour la suite. Obstacles (O) Les freins, risques, ce qui empêche ou pourrait empêcher d’avancer. Et là, c’est magique (ou presque) : on sort du « ça va, ça va pas » pour, enfin, donner un regard dynamique et presque… inspirant, au bilan d’équipe. Franchement, la première fois que j’ai utilisé la matrice, j’ai été bluffé par la quantité d’idées (et de blocages souvent tus !) qui sont apparues, pile en face de moi. Pour les mordus de innovation incrementale, c’est du pain béni pour un plan d’action ! Comment utiliser la matrice SEPO pour améliorer la performance de votre équipe Vous vous demandez comment faire un SEPO, concrètement ? C’est bien plus simple qu’il n’y paraît. Là, je parle vraiment d’expérience : je commence toujours par une question toute bête à l’équipe, genre : « Qu’avons-nous accompli ces derniers mois, et où veut-on aller maintenant ? » Construire une matrice SEPO : guide pas à pas Réunissez l’équipe : 6, 8, 12 personnes… pas plus sinon, c’est la cacophonie. Chacun reçoit des post-its ou un tableau partagé. Expliquer les 4 axes : je répète, pas de stress – ces termes doivent parler à tout le monde, sinon on les reformule ensemble. Laissez 10-15 minutes pour que chacun écrive, sur des post-its ou dans un fichier partagé, ce qu’il pense sur chaque axe. Puis… mise en commun collective. On regroupe les points similaires, on discute sans juger. Bilan rapide : on cible ensemble les priorités à traiter (surtout dans les potentialités et les obstacles). À chaque étape, je tâche de rebondir sur les divergences. Croyez-moi, c’est là que sortent les vraies bonnes idées. Et, après cette séance, j’ai très souvent ressenti – et vu dans l’équipe – une dynamique nouvelle : on ne subit plus le bilan, on le construit ensemble. Les avantages de la matrice SEPO dans l’évaluation des projets Clarté et simplicité : on visualise en 20 minutes ce qui traînait parfois pendant des mois dans l’implicite. Effet catalyseur : les idées sortent parce que chacun est écouté, pas jugé. Meilleur suivi : des pistes d’action concrètes émergent à chaque fois. Cohésion d’équipe renforcée : tout le monde repart avec une vision claire ET le sentiment d’avoir contribué. J’aurais aimé découvrir cet outil plus tôt… En vrai, ça m’a évité des réunions interminables (et beaucoup d’ennui). Et c’est adaptable partout. Par exemple pour améliorer le mapping concurrentiel après un lancement de produit, ou lors d’un changement stratégique. La matrice SEPO face à la matrice SWOT : similitudes et différences Évidemment, je me dis que vous allez vouloir comparer. Même moi, la première question qui m’est venue à l’esprit : « Mais alors, SEPO ou SWOT, c’est pas la même chose… ?» Eh non. Même si, à première vue, c’est très proche. Je vous détaille ça juste ici : Critère Matrice SEPO Matrice SWOT But principal Bilan d’étape, amélioration continue, regard sur l’action passée ET future Analyse stratégique « photographie » à l’instant T, en vue de décisions Axes Succès, Échecs, Potentialités, Obstacles Forces (Strengths), Faiblesses (Weaknesses), Opportunités, Menaces Démarche Auto-évaluation participative, dynamique de groupe Analyse (souvent) descendante ou individuelle, plus théorique Temps Prospectif ET rétrospectif Instantané, centré sur le moment présent Application Projet, équipe, changement opérationnel Stratégie générale, positionnement, études de marché La vraie force de la matrice SEPO, à mon goût ? On ne fait pas que lister, on rebondit : les potentialités s’appuient sur les succès et les échecs, et l’on regarde tout de suite ce qu’on va faire « demain ». C’est aussi pour ça qu’elle plaît autant en équipe agile… (Si vous bossez sur l’optimisation du calcul indice de vente, par exemple, l’aspect tourné vers la projection peut vraiment vous aider à gagner en réactivité collective.) Conseils pratiques pour réussir une séance d’auto-évaluation avec la matrice SEPO Préparez une question clé : ça cadre et évite que ça parte dans tous les sens. Posez le cadre : « pas de censure, bienveillance maximales » (sinon, personne n’osera sortir les vrais obstacles… j’ai testé, ça fait
Comprendre la méthode OSBD : l’outil clé pour une communication non violente efficace

🔍 En bref : la méthode OSBD en 6 points essentiels O comme Observation : décrire les faits sans jugement S comme Sentiment : exprimer honnêtement votre ressenti B comme Besoin : identifier l’attente sous-jacente D comme Demande : formuler clairement ce que vous souhaitez Outil central de la communication non violente (CNV) pour désamorcer les conflits, surtout au travail Appliquée au management, elle favorise la coopération et l’écoute – simple, puissant, souvent bluffant ! Vous cherchez un mode d’emploi pour éviter les conflits et désamorcer les tensions, surtout au boulot ? La méthode OSBD, c’est un peu la trousse de secours de la communication empathique. Je vous explique, mais avant… si la gestion d’équipe vous titille, je vous suggère franchement de jeter un œil aux 5 forces de porter (indispensable pour cerner les dynamiques de pouvoir) ou de découvrir les réflexes autour du comité d’entreprise. Bref, tout se recoupe ! Qu’est-ce que la méthode OSBD ? Définition et origine Derrière ce drôle de sigle, il y a une méthode qui, franchement, mérite d’être connue. OSBD, pour Observation, Sentiment, Besoin, Demande, c’est LA formule magique de la communication non violente (CNV). Inventée (ou plutôt, structurée) par Marshall Rosenberg, un psy américain qui s’est arraché les cheveux à comprendre pourquoi on passe notre temps à s’engueuler — et comment en sortir sans dégâts collatéraux. Honnêtement, depuis que j’ai intégré quelques bribes de cette méthode, mes échanges pro, mes discussions d’équipe, ou même quand il faut dire à mon boss qu’un projet patine… bah, on s’en sort tous mieux ! Détailler les 4 étapes de la méthode OSBD Étape Définition concrète Exemple rapide Observation Décrire un fait SANS jugement ou interprétation « La réunion a commencé à 10h10, pas à 10h. » Sentiment Exprimer ce que l’on ressent (émotion, sensation) « Je me sens frustré(e) » Besoin Identifier le besoin sous-jacent « J’ai besoin de ponctualité pour avancer sereinement » Demande Formuler clairement ce que vous attendez « Pourrais-tu prévenir si tu risques d’être en retard ? » J’insiste : pas d’accusation, pas de reproche, rien de personnel – on “constate”, on “exprime”, on “partage un besoin”, puis on “demande”. Parfois, c’est simple sur le papier… moins dans l’instant, croyez-moi ! Mais dès qu’on s’entraîne, on sent que les échanges changent. Et tout ce qui suit, c’est du bonus. La méthode OSBD dans le cadre de la communication non violente (CNV) OSBD, c’est le cœur de la communication non violente (CNV) Les 4 piliers de la CNV : Observation, Sentiment, Besoin, Demande — pile poil OSBD (pas plus compliqué !) Principe : bâtir une communication basée sur l’écoute, sans jugement, pour plus de respect et d’authenticité Utilisée dans le management mais aussi dans la vie perso et familiale Voilà, OSBD n’est pas seulement “une méthode” — c’est la colonne vertébrale de toute démarche CNV. Perso, la première fois qu’on m’a expliqué ça, j’ai dû refréner l’envie de répondre “oui mais dans la vraie vie…”. Sauf que, finalement, à force de la pratiquer, même maladroitement… c’est fou comme ça désamorce. Allez voir aussi, quand vous aurez le temps, comment certaines méthodes comme le management innovant s’articulent avec des outils comme OSBD. Comment appliquer la méthode OSBD au quotidien ? Oui, la théorie c’est sympa, mais la viande, c’est : comment je m’y prends concrètement, surtout sous tension ? J’ai fait des gaffes, j’ai cafouillé, je me suis parfois “osbédifié” tout seul dans ma tête avant d’oser l’ouvrir en réunion… Utiliser la méthode OSBD pour éviter les conflits Rédiger ou préparer à l’avance vos 4 étapes clés Prendre le temps de respirer avant de formuler, pour éviter de juger Appliquer OSBD même dans des échanges par écrit (mails professionnels, notes de service…) Formuler à la première personne : “je” ressens / “j’ai besoin” / “je demande” En vrai, ce qui compte, c’est d’y aller petit à petit. Parfois, au début, ça sonne “bizarre”, un poil scolaire. Mais, franchement, plus on pratique, plus ça devient naturel, surtout pour désamorcer un échange qui tourne au vinaigre. Ne pas confondre OSBD avec de la politesse “béate”. Non. Ça va plus loin : on n’esquive pas le problème, on le pose, proprement, sans bousculer l’autre ! Exemples pratiques et exercices avec la méthode OSBD Exemple 1 : Rien ne s’améliore lors des réunions d’équipe ? Observation : “Plusieurs réunions s’achèvent sans action concrète.” Sentiment : “Je suis découragé.” Besoin : “J’ai besoin de clarté sur les responsabilités.” Demande : “Pourrait-on terminer chaque réunion par une répartition claire des tâches ?” Exemple 2 : Conflit récurrent avec un collègue ? Observation : “Il est arrivé trois fois que les délais n’aient pas été respectés ce mois-ci.” Sentiment : “Je crains de devoir tout rattraper.” Besoin : “J’ai besoin de fiabilité dans l’équipe.” Demande : “Comment pourrions-nous faire pour mieux anticiper ces retards ?” À force d’essayer (et parfois… de se tromper), j’ai fini par bricoler mon propre “bonhomme OSBD” collé devant l’écran, histoire de m’en rappeler. Si vous aimez les supports visuels, on en reparle en fin d’article pour les fiches et outils PDF à télécharger. En attendant, je vous invite à comparer ça à la façon dont on structure un bilan simplifié en comptabilité — on décortique, étape par étape. Eh ouais ! La méthode OSBD en entreprise et management Attention, terrain miné ici. Si vous managez, ou, pire, si VOUS êtes managé, les tensions, ça explose vite. Et pourtant, appliquer OSBD peut sérieusement changer la donne. J’ai vu des chefs de projet passer du mode dictatorial au mode “coach inspirant” – et pas du jour au lendemain, faut pas rêver, mais petit à petit, ça pénètre. Les bénéfices de la méthode OSBD pour les managers Bénéfice Description concrète Améliore la confiance Des demandes claires, moins de “non-dits” — l’équipe respire Diminue les conflits On sort du reproche, chacun peut s’exprimer sans peur Renforce l’empathie Le manager capte les besoins cachés, ajuste son management Perso, j’ai vu des comités complètement figés débloquer d’un coup grâce à une simple séquence OSBD. Bon, OK, pas à tous les coups, mais très souvent, ça change le climat. Si jamais le sujet RH vous branche, allez voir la notion d’annualisation du temps
Le marketing mix : définir et maîtriser les leviers essentiels de votre stratégie
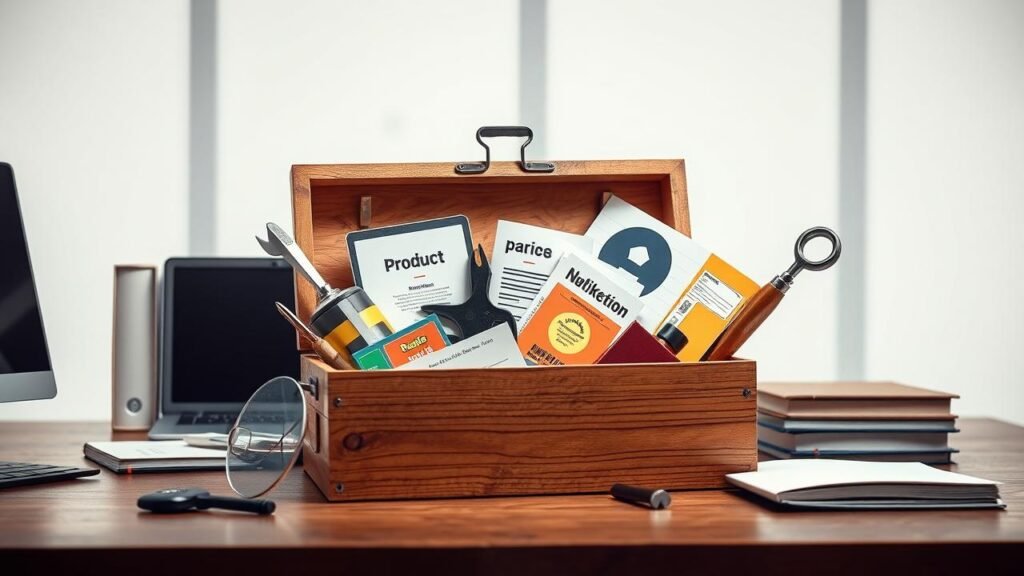
En bref : comprendre le marketing mix (et l’appliquer tout de suite) 📌 Le marketing mix : mon conseil de base pour piloter une stratégie qui tient la route, sans se perdre dans la complexité. Voici les points à retenir si vous êtes pressé – ou juste allergique aux phrases trop longues : Le marketing mix c’est l’ensemble des actions pour “vendre mieux”. Les fameuses 4P : produit, prix, place (distribution), promotion (communication). Il existe les variantes : 5P, 7P (on en parle juste après) Définissez chaque pilier pour booster vos résultats… et ajustez souvent ! Exemples, conseils, check-list rapide : tout ce qu’il faut dans cet article. Vous cherchez comment appliquer concrètement la méthode des 4P? Ou vous vous demandez si les 7P vous concernent ? Restez avec moi, j’ai vu de sacrées erreurs sur ces sujets ! D’ailleurs, si vous travaillez dans le retail ou que l’analyse concurrentielle vous parle, pensez à jeter un œil aussi au passage sur mapping concurrentiel – c’est hyper complémentaire avec le marketing mix. Qu’est-ce que le marketing mix ? Comment définir le marketing mix ? C’est LA question basique mais qu’on zappe parfois… Désolé, mais si vous me demandez mon avis (et je sais que vous le faites) : il faut toujours partir de là. En deux mots – trois, allez – le marketing mix, c’est tout simplement l’ensemble des décisions stratégiques et opérationnelles qui permettent, pour une entreprise, de proposer son offre au marché. Ni plus, ni moins. Concrètement, c’est un peu comme avoir une boîte à outils (toujours le même principe), mais pour attirer, convaincre et fidéliser les clients. Définition marketing mix : actions coordonnées autour de plusieurs “leviers” (les P, on y vient) pour atteindre les objectifs de vente et de notoriété. Il a été popularisé dans les années 60 avec les 4P (Product, Price, Place, Promotion) et n’a pas pris une ride – ou presque. L’idée ? Penser à tous les maillons de la chaîne – pas juste le produit ou le prix. Ce que j’adore dans ce concept, c’est sa simplicité… Si vous ratez un des P, vous ratez souvent tout le reste (et franchement, j’en ai vu passer des stratégies bancales). À ce sujet, n’oubliez pas : connaître le 5 forces de Porter vous permettra aussi de comprendre l’environnement concurrentiel avant même de déployer chaque P de votre marketing mix. Composants marketing mix Produit Prix Place (distribution) Promotion (communication) Au final, le marketing mix reste la base. À mettre à jour sans arrêt – croyez-moi, c’est pas un plan figé à vie ! D’ailleurs, dans certains cas, il y a un “cinquième” voire un “septième” P… Et là, ça devient franchement intéressant. Les 4P du marketing mix : les bases incontournables Les 4P du marketing mix en détail : produit, prix, place, promotion Vous voulez savoir : Quels sont les 4P du marketing mix ? Voilà, c’est maintenant ou jamais. Je vais droit au but, parce que si vous loupez ça, tout tombe à l’eau. Promis, c’est du vécu. Les fameuses 4P, ce n’est pas du pipeau : Produit : la “star” de votre mix. Ce que vous vendez. Caractéristiques, packaging, marque, gamme, innovation… Bref, tout ce qui fait que ça donne envie ou pas. Prix : combien ? C’est ce qui va aider (ou freiner) la décision d’achat. Pensez stratégie d’écrémage, penetration, discount, prime… Place (Distribution) : où et comment votre produit/service est-il disponible ? Vente directe, distributeur, e-commerce, marketplace, points de vente physique… Promotion (Communication) : comment on fait savoir que ça existe ? Publicité, réseaux sociaux, promo, relations presse, événements… Petit conseil personnel : souvent, je vois des entreprises qui bossent 80 % sur le produit et 10 % (ou même 0, soyons francs) sur la distribution. Mais un super produit sans canaux adaptés… il reste dans l’entrepôt, pas chez le client. Vous me suivez ? Si oui, pensez aussi à optimiser le credit bail avantages et inconvenients si votre stratégie implique souvent des financements pour vos offres – c’est parfois un game changer. P Ce qu’il couvre Exemples concrets Produit Design, fonctionnalité, SAV, marque iPhone, gamme bio, outils personnalisés Prix Politique tarifaire, remises, options Premium, entrée de gamme, bundles Place Canaux, points de vente, web, réseau Site e-commerce, boutiques, partenaires Promotion Média, pub, digital, influence… Campagne Facebook, TV, Influenceurs Voilà pour la base. Ah, et on me demande souvent si “ordre” des P est important ? En vrai, ça dépend de votre activité. Mais commencez par bien ficeler chaque composant, c’est déjà ça de pris. Exemples concrets d’applications du marketing mix en entreprise Bon, la théorie c’est bien joli, mais dans la vraie vie ça donne quoi ? Un artisan boulanger booste ses ventes grâce à une offre spéciale de baguettes bio (Produit/Promotion) + extension de la livraison à domicile (Place). Une start-up SaaS propose trois tarifs d’abonnement pensés pour différentes cibles (Prix) et lance un webinaire viral pour le lancement (Promotion/Place Digital). Une boutique de vêtements revoit son packaging éco-responsable (Produit), baisse les prix sur la gamme été (Prix) et communique sur Insta + affichage local (Promotion/Place). Soyez inventif, mais ne vous éparpillez pas ! Diagnostic rapide : relisez chaque P, repérez la faille, ajustez. Besoin d’une démarche structurée ? Je vous recommande vivement de lire aussi la partie mapping concurrentiel pour voir ce que font vos voisins – ou rivaux ! – sur le marché. Le marketing mix : variantes et évolutions (5P, 7P) Le marketing mix : pourquoi et comment intégrer les 7P à votre stratégie Là, on va un cran plus loin – et franchement, ça fait la différence selon le secteur. Vous vous demandez Quels sont les 5P du mix marketing ? Ou même les 7P ? Je vous explique, pas de panique. Le métier a changé, le monde aussi, alors on a ajouté des « P » au fil du temps pour coller aux réalités business modernes (services, digital, B2B…). Modèle P supplémentaires Utilisé pour 5P People (personnel/contact humain) Services, retail, premium, conseil 7P People + Process + Physical evidence (Preuves matérielles) Services, hôtels, santé, digital avancé People
Tout savoir sur le bail précaire commercial : définition, durée et conditions

🔎 En bref : Bail précaire commercial = location professionnelle pour tester une activité ou occuper un local provisoirement, sans s’enfermer dans un bail longue durée. Durée maxi : 3 ans cumulés, non renouvelable. Après ? Obligé de basculer en bail commercial classique. Préavis court, rupture facile. Souplesse… mais prudence sur le formalisme. Idéal pour : entrepreneurs, commerçants, professions libérales (hors logement et habitation, clairement !). Encadrement légal 2025 inchangé : attention à l’effet de seuil… Risque de requalification si on dépasse le cadre ! Ce qui m’a souvent marqué, c’est le nombre d’indépendants qui négligent le risque de dépasser les 3 ans. J’ai moi-même failli tomber dans le piège lors d’un premier bail pour une petite boutique. Si vous hésitez encore entre bail classique et bail de courte durée, vous pouvez jeter un œil sur bail precaire commerce pour creuser ce qui se joue dans votre secteur. C’est fou, le nombre de questions qui tournent autour du bail précaire commercial. Je peux vous dire : la plupart des pros se font une montagne de ce contrat… alors qu’il sauve la mise quand on veut bouger vite, tester une idée, ou éviter de s’enfermer. Voilà, je pose les bases. Si vous cherchez du jargon, vous allez voir qu’on y coupe pas. Mais je vais tout décortiquer. Avec un peu de vécu (oui, j’en ai planté un, et aussi sauvé quelques collègues d’une vraie galère administrative). Qu’est-ce que le bail précaire commercial ? Définition juridique et cadre légal du bail précaire commercial Bon, allons-y franchement : qu’est-ce que ce truc qu’on appelle “bail précaire commercial” ? Eh bien, c’est un contrat de location dérogatoire à la loi sur les baux commerciaux. On l’appelle d’ailleurs aussi bail commercial courte durée ou bail dérogatoire. Le but ? Permettre à un locataire professionnel (commerçant, artisan, industriel, profession libérale…) d’occuper légalement un local commercial pour un temps court – typiquement, pour tester une activité ou profiter d’une opportunité temporaire (saisonniers, pop-up store, événements…). Ah, et attention : la loi encadre tout ça. Depuis 2014 et la loi Pinel, le bail précaire commercial ne peut pas dépasser 3 ans cumulés. Ni pour un atelier. Ni pour un bureau. Et surtout PAS pour un logement ! On exclut l’habitation, c’est vital. Différence entre bail précaire commercial et bail commercial classique Bail précaire commercial Bail commercial classique Durée maxi 3 ansNon renouvelable au-delàPas d’accès au droit au renouvellement Résiliation simplifiéePréavis court Plus souple, mais plus risqué si on dérape Durée standard 9 ansRenouvellement automatique possibleDroit au renouvellement Résiliation plus encadréeIndemnités d’éviction Stabilité, sécurité… mais contraignant Pour moi, la différence clé, c’est la flexibilité contre la sécurité. J’ai vu des entrepreneurs renoncer à un bail classique, effrayés par les 9 ans. Mais à l’inverse, il ne faut pas oublier que le bail commercial donne accès à des droits très protecteurs en cas d’échec ou de rachat. Vous jonglez avec plusieurs options ? Pour d’autres modèles hybrides, le credit bail avantages et inconvenients explore les alternatives financières qu’on croise souvent sur le marché des pros. Durée et renouvellement du bail précaire commercial Durée maximale de 3 ans et interdiction de renouvellement du bail précaire commercial La règle, c’est simple : durée cumulée 3 ans, pas une minute de plus. C’est là que beaucoup se font piéger : signer un “premier bail de 12 mois” puis tenter de repartir sur le même schéma… faux ! Dès que la somme des baux successifs (avec le même locataire, ou souvent, le même local) dépasse 3 ans, le contrat se REQUALIFIE AUTOMATIQUEMENT en bail commercial traditionnel. Et là… aïe, indemnités, protections, cadre lourd. 1er bail précaire commercial : 18 mois Renouvellement (possible, mais dans la limite des 3 ans cumulés) : 12 mois supplémentaires Prolongation d’1 an ? Non, c’est interdit dès que 3 ans atteints. Obligation de passer à un bail de 9 ans classique. Exemple : J’ai vu un café tenter trois baux de 12 mois d’affilée, puis demander une 4e prolongation. Verdict du juge ? Bail commercial “classique” imposé. Mauvaise surprise, fin de la souplesse et coûts cachés… Un cauchemar ! Cas particuliers de renouvellement et cumul des baux précaire commerciaux On entend parfois “et si on change le nom du locataire ?”. Ça ne marche pas. Les tribunaux sont clairs : l’intention de contourner la loi finit toujours par provoquer une requalification. Le cumul ne peut se faire qu’avec le même bailleur et le même local. Changer d’entreprise à la même adresse en trompe-l’œil ? Les juges n’aiment pas du tout. Toujours retenir : au-delà de 3 ans, plus possible de signer de bail précaire commercial. Au-delà, on entre dans la logique des baux commerciaux classiques, et tout ce que ça implique. Avantages et inconvénients du bail précaire commercial Avantages pour le locataire et le bailleur d’un bail précaire commercial Flexibilité extrême : testez un concept, occupez un local “en attendant”, solutionnez un besoin temporaire. Rupture plus simple : préavis réduit, pas d’indemnité d’éviction, sortie sans pénalité (sauf stipulation particulière… attention aux pièges !). Idéal pour le bailleur aussi : pas engagé sur 9 ans, récupération du local rapide si projet plus ambitieux ou repreneur. Pour les locataires frileux ou cash-light : pas de dépôt massif ou longs préavis comme en bail classique. Dans la vraie vie, je pense surtout à ceux qui lancent un commerce éphémère, ouvrent un pop-up, ou veulent “tester la zone”. J’ai accompagné un foodtruck sur ce format l’an passé, et franchement, ce fut le bon move. Le proprio aussi, ravi de garder la liberté de reprendre son espace. Risques et limites à connaître : les inconvénients cachés du bail précaire commercial Pas de droit au renouvellement : au bout de 3 ans, le bailleur peut refuser de continuer sans explication. Protection limitée : pas d’indemnité en cas d’éviction soudaine, sauf si la rédaction du bail est ambiguë (on en parle… souvent !). Risque de requalification : dépassement du seuil = bascule en bail commercial, conséquences juridiques et financières. Formalités pointues : le bail doit
Orus avis : que pensent vraiment les clients de cette assurance professionnelle ?

🔍 En bref : orus avis – ce qu’il faut retenir en 30 secondes Plus de 2 000 avis clients sur Trustpilot : note moyenne 4,9/5 Assurance RC Pro, mutuelle et décennale spécialisées pour pros et freelances Service client jugé rapide, humain et efficace Tarifs parmi les plus compétitifs du marché pro Processus d’inscription et de résiliation ultra-simplifié Site web fluide, conseils personnalisés Honnêtement, si vous cherchez des infos fraîches côté avis orus, impossible de passer à côté de ces retours massifs. L’image pro-friendly d’Orus se démarque nettement. Pour élargir votre réflexion sur la gestion moderne des pros, allez jeter un œil à amberscript avis, histoire de comparer avec d’autres outils digitaux utiles. Orus avis : pourquoi ce choix séduit les professionnels Les principales assurances proposées par Orus RC Pro Orus (Responsabilité Civile Professionnelle) Mutuelle santé Orus Assurance décennale Orus Alors, pourquoi j’ai craqué, moi ? Déjà, Orus avis revient en force partout avec ces trois produits phares. RC pro Orus avis : pour les indépendants, consultants, auto-entrepreneurs… Si vous avez déjà cherché une auto-entrepreneur ou sasu, vous savez que la RC Pro c’est le sésame incontournable. Mutuelle Orus : franchement, la flexibilité des formules, ça m’a bluffé. Je n’ai pas eu à détailler mon arbre généalogique pour un devis… Un détail qui fait plaisir. Décennale Orus : Là, c’est destiné aux métiers du BTP et à tout ce qui met les mains dans le cambouis. Beaucoup de pros galéraient à trouver une décennale abordable, visiblement Orus rafle la mise côté simplicité. Et au quotidien, aucune lourdeur à déclarer un sinistre ou à obtenir une attestation. J’ai testé, réponse par mail sous 3h. Vous me direz, normal en 2024, mais ce n’est pas le cas partout. Le parcours client selon les avis Orus Inscription fluide (5 mn chrono selon la majorité des avis Orus) Espace client clair, intuitif, y compris sur mobile Réponses courtes, sans bot automatique redondant Accompagnement humain à chaque étape Je ne vous mens pas : sur Trustpilot, c’est l’avalanche de retours positifs sur ce fameux parcours client Orus. Je me suis amusé à comparer sur la page credit bail avantages et inconvenients les process de souscription dans la finance : on est à des années-lumière. Ici, dès l’inscription, tout vous est expliqué. Parfois même, un conseiller vous appelle, non pas pour vous vendre un bonus, mais juste vérifier si votre contrat colle à vos besoins. En résumé : simplicité et transparence, deux valeurs qu’on retrouve sincèrement dans les orus avis – pas juste du marketing. Orus avis : quelles sont les forces et limites relevées par les utilisateurs ? Points forts signalés dans les avis Orus Service client à l’écoute et humain Devis clairs, prix affichés sans surprise Aucune paperasse : tout digitalisé Délais de traitement très courts Solution adaptée aux freelances et TPE Bon, ça c’est le menu officiel, mais dans les avis orus trustpilot, ce que je note surtout : “Service client au top, joignable facilement”, “Paiement rapide en cas de sinistre”, ou encore “Équipe réactive, on sent qu’on n’est pas juste un numéro”. Ces phrases reviennent tout le temps. Honnêtement, sur le nombre de plateformes où je me suis inscrit, jamais eu un tel niveau “proximité humaine”. Oui, il y a de l’IA derrière, mais jamais intrusive. Petit coup d’œil rapide au comparatif ci-dessous, pour mieux visualiser : Forces mentionnées dans les avis Orus Périmètre Service client réactif, empathique Tous contrats et démarches client Prix bas, devis transparents RC Pro / Mutuelle / Décennale Souscription express en ligne Toute la gamme Assistance humaine (appel, mail, chat) Support pro Contrats adaptés à chaque métier Indépendants, PME, TPE Points d’amélioration souvent cités Pas encore tous les métiers couverts (architecture et médical : à surveiller) Limite parfois dans la personnalisation avancée des contrats Plateforme mobile : petits bugs signalés mais vite corrigés Gestion de certains dossiers complexes (sinistres > 30 000 €) encore perfectible Côté bémols : je ne vais pas vous cacher que rien n’est parfait. Dans les orus avis un peu chafouins, on lit “Application mobile parfois capricieuse”, “Certains métiers un peu oubliés”, “Suivi de sinistres lourds perfectible”. Bref, Orus grandit vite et ça se sent. Mais – et c’est rare – à chaque fois les équipes répondent publiquement sur Trustpilot, s’excusent, proposent un rendez-vous. Une humilité quasi jamais vue dans l’assurance. Et ce n’est pas du pipeau, pour avoir suivi certains de mes clients accompagnés chez Orus. Ceux qui veulent s’éviter ces désagréments ont parfois mixé leur assurance Orus avec d’autres solutions, comme ElgeaWeb ou des offres de 123 paie. Orus avis : comment souscrire et quelles sont les conditions ? Processus de souscription simplifié Devis immédiat en ligne (moins de 3 minutes) Signature électronique à distance Attestation disponible instantanément Paiement CB ou prélèvement SEPA Accompagnement humain possible à chaque étape J’insiste : le jour où j’ai testé Orus, je me suis retrouvé, en pleine nuit, à vouloir un devis RC Pro. Deux minutes, chrono. Pas d’appel commercial, pas de relance agressive. Quelques clics, c’est fait. Si vous avez déjà testé un process du style, genre pour une messagerie akeonet ou une souscription bancaire… vous comprenez la différence. Côté tarif, ça commence à moins de 10 €/mois pour certaines couvertures. Ce n’est pas un prix d’appel pour pigeons, c’est la vraie offre. Bon, si votre activité est à risques, la facture grimpe, mais tout est détaillé ligne par ligne. Résiliation et service client selon les avis Résiliation possible en 3 clics, sans lettre recommandée Service client ultra-joignable (chat, mail, téléphone) Délais de traitement rapides (48h-5j selon motif) Pas de frais cachés à la sortie Ce qui m’a marqué, en lisant les avis orus : “Résilier c’est aussi simple que de souscrire”. Et franchement, c’est assez rare pour le souligner. Certains affirment que, même après résiliation, il reste un suivi pour s’assurer que tout s’est bien passé côté client. J’ai d’ailleurs filé un coup de main à un copain qui voulait migrer d’une offre Orus à une assurance concurrente. Contact email, accusé de réception en deux heures, contrat résilié en moins de 4 jours. Si vous cherchez la tranquillité sur la résiliation orus, c’est du solide.
Tout savoir sur la remise commercial : définition, calcul et mise en pratique

💡 En bref : La remise commercial est une réduction tarifaire accordée pour motiver, fidéliser ou solder. Se calcule en % ou en € : prix initial x (1-taux de remise/100) = prix remisé. Différente du rabais, de la ristourne et de l’escompte. Exemple : 10% sur 300 € = 270 € à payer. Existe en version exceptionnelle ou sur volume. Doit, par la loi, être clairement mentionnée sur les factures. Peut s’annoncer dans un mail ou une lettre commerciale. Voilà, c’est posé. Si vous voulez aller à l’essentiel, vous l’avez. Mais pour tout comprendre, maximiser votre politique tarifaire, et surtout éviter les pièges ou erreurs classiques quand on fait une remise commercial… Je vous invite à lire la suite. Et franchement, ce serait dommage de rater les exemples concrets et les astuces de pro que je vais partager. Si vous aimez les sujets business, vous devriez aussi jeter un œil à notre article sur le credit bail avantages et inconvenients ou sur le 5 forces de porter, histoire de pousser la réflexion stratégique. Allez, on y va ! Qu’est-ce qu’une remise commercial ? Définition et différences avec rabais, ristourne et escompte On confond tout le temps : remise commercial, rabais, ristourne, escompte. J’ai mis un temps fou à piger la différence à mes débuts, je vous le dis franchement. La remise commercial, c’est une réduction consentie d’emblée sur le prix, généralement pour un gros client, une commande importante, ou pour récompenser la fidélité. Le rabais : c’est une réduction exceptionnelle, souvent justifiée par un défaut produit, un retard, une casse… On n’avait pas prévu, on s’ajuste. La ristourne ? Pareil, mais elle intervient a posteriori, sur l’ensemble des achats ou du chiffre d’affaires réalisé sur une période, en mode bonus de fidélité. L’escompte, alors ? C’est une réduction financière offerte si le client règle plus vite que prévu (paiement anticipé). Voilà le tableau : Type Définition Quand ? Remise commercial Réduction de prix accordée d’emblée pour encourager achat/gros volume/fidélité Au moment de la commande Rabais Réduction ponctuelle pour défaut produit ou litige En cas de problème après-vente Ristourne Réduction calculée sur la globalité des achats d’un client sur une période Fin de période (mois/trimestre/année) Escompte Réduction pour paiement anticipé Sur la facture, si paiement rapide À retenir : sur la facture, mentionnez toujours la nature de la réduction commerciale. Je vous assure, éviter des mauvaises surprises lors d’un contrôle ou d’un litige… ce n’est pas du luxe. Les 3 types de réductions commerciales principales On regroupe, en France surtout, les réductions commerciales sous trois formes : Remise commercial : accordée lors de la vente. Classique. Facile à comprendre. Rabais : accordée après coup. Surtout quand il y a un bug, une erreur… Ristourne : cumulée sur volume ou CA à la fin d’une période. Un système de récompense, en somme. Chacune a ses règles et, surtout… ses effets en compta. En général, la remise commercial impacte directement le prix de la facture initiale. Le rabais vient en déduction en cas de facture rectificative. La ristourne fera, souvent, l’objet d’une note de crédit plus tard. Pas simple à suivre ? Je vous rassure, c’est normal. J’ai dû me faire un mini-mémo pour éviter de mélanger. Justement, dans l’article sur le bilan simplifie comptabilite, je détaille comment ces opérations influencent la compta. Vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil. Comment calculer une remise commercial ? Méthode pour calculer une remise commercial en valeur ou pourcentage La formule pour calculer une remise commercial, c’est pas bien sorcier mais il faut la connaître par cœur. On fait comme ça : Remise commercial en pourcentage : Prix initial x (1 – taux de remise/100) = Prix final Exemple : 200 € x (1 – 15/100) = 200 x 0,85 = 170 € Remise commercial en valeur : Prix initial – montant de remise = Prix final Exemple : 200 € – 20 € = 180 € Astuce : Si vous avez besoin de connaître le taux de remise commercial à partir des montants (parfois, ça m’arrive quand je veux décortiquer une facture…), la formule : Taux de remise (%) = [(Prix initial – Prix remisé)/Prix initial] x 100 Petit aparté : ne vous fiez jamais aux outils de calcul online sans vérifier le détail. J’ai déjà vu des erreurs improbables. Vous êtes souvent amené à combiner remise commercial et autres opérations comme le calcul indice de vente ? J’ai justement expliqué comment tout relier dans notre article sur le calcul indice de vente. Faites tourner la calculette! Exemples concrets de calculs de remise commercial Rien ne vaut un exemple précis, vous êtes d’accord ? Voici une petite mise en situation : Prix initial (TTC) Taux de remise commercial Montant de la remise (€) Prix après remise (€) 500 € 12 % 60 € 440 € 120 € 25 % 30 € 90 € 300 € 10 % 30 € 270 € Concrètement : si vous proposez une remise commercial exceptionnelle de 15% sur une facture de 2 000 €, le calcul c’est : 2 000 € x (1 – 0,15) = 1 700 €. La remise accordée au client est de 300 €. Le plus dur pour moi, c’est que parfois le client demande une remise sur le prix TTC, parfois sur le prix HT. Soyez bien attentif à la base de calcul : c’est une source d’erreur fréquente, surtout dans la précipitation ou le stress d’un closing compliqué. Comment formuler une remise commercial dans votre communication ? Modèles et exemples de lettres ou courriels proposant une remise commercial Un client fidèle, une situation tendue, ou juste une promo à lancer ? Savoir formuler une remise commercial, c’est tout un art. Voici deux modèles que j’utilise, selon l’occasion. Vous pouvez les copier-coller, adapter, c’est fait pour ça : Modèle de mail court : Madame, Monsieur, Afin de vous remercier pour votre fidélité, j’ai le plaisir de vous accorder une remise commercial de 10% sur votre prochain achat. Le nouveau montant s’élève donc à XXX €. Restant à votre disposition, Cordialement, Modèle de lettre plus “pro” : Madame, Monsieur, Suite à votre demande, et dans le cadre de nos échanges, je vous confirme l’application d’une remise commercial exceptionnelle de XX% sur la facture n°XXX, soit un
Société transparente : définition, fonctionnement et implications fiscales

🧐 En bref : société transparente, l’essentiel à retenir Une société transparente n’est pas imposée en son nom : ce sont les associés qui paient l’impôt directement sur les revenus, en fonction de leur part. Le régime concerne surtout les SCI et certaines sociétés civiles françaises. Pas de double imposition (société + associés), on ne tape qu’une fois. Société translucide, opaque, semi-transparente : nuances à bien comprendre. Avantages : fiscalité souple, transmission facilitée. Inconvénients : responsabilité et imposition parfois lourdes pour les associés. Vous voyez, en quelques points, c’est déjà plus clair ! Si vous comparez ce mécanisme à d’autres modes d’imposition, comme le credit bail avantages et inconvenients, ou même la gestion de bilan simplifie comptabilite, la société transparente, honnêtement, c’est un sacré ovni juridique et fiscal. Accrochez-vous. Qu’est-ce qu’une société transparente ? Définition brute : une société transparente, c’est une société dont le résultat fiscal n’est pas imposé au niveau de la société elle-même : il est directement imposé entre les mains des associés, à proportion de leurs droits dans la société. Ce n’est pas la société qui « paie l’impôt », mais bien les personnes qui la possèdent. En pratique ? Imaginez, vous détenez 50 % d’une SCI avec un ami. Chaque année, c’est vous qui allez déclarer 50 % des bénéfices (ou déficits !) sur votre propre feuille d’impôt, comme si c’était un revenu à vous. La société fait son résultat fiscal (bénéfice ou déficit). Ce résultat « remonte » chez les associés sans être taxé à la source société. Chacun paie selon sa tranche d’impôt sur le revenu. C’est parfois un bon plan. Mais pas toujours. C’est là où il faut voir au cas par cas, car les régimes fiscaux société peuvent être piégeux. Et ça n’a rien à voir avec la transparence au sens moral ! On est à 100 % dans la technique fiscale ici. Au passage, si vous voulez checker l’impact organisationnel, le comite d entreprise definition peut vous donner une autre piste sur la gouvernance… Société transparente : le régime fiscal expliqué Bon, pourquoi ce système a-t-il été inventé ? Pourquoi imposer les associés et pas le véhicule société ? C’est une logique : certaines sociétés n’ont pas vocation à « faire du commerce », mais à gérer un patrimoine. Les revenus (loyers, plus-values) reviennent in fine aux associés, alors autant les toucher au portefeuille tout de suite ! Pas de couche d’impôt en plus pour la société : simplicité, mais… attention Point fort Point faible Pas de double imposition Montée rapide dans les tranches d’IR Déficits « transparents » (retombent chez l’associé) Associé responsable des dettes fiscales Transmission facilitée Pas possible d’opter pour la flat tax Ce tableau : si simple, et déjà les grandes lignes. Encore une fois, attention à ne pas tomber dans le piège du « c’est forcément meilleur pour mes finances ! » J’ai croisé pas mal d’associés qui se sont retrouvés avec un effet boomerang fiscal après une bonne année de location… J’y reviens plus bas avec des exemples. Fonctionnement de la société transparente au niveau juridique Juridiquement, il y a aussi un truc à savoir. La personnalité morale (la société « existe » en tant que personne devant la loi) n’a rien à voir avec sa personnalité fiscale (qui paie l’impôt). Une société peut exister, signer des contrats, mais… ne pas être imposée ! C’est fou, non ? Société transparente : personnalité morale propre, mais fiscalité « relayée » aux associés Société opaque : impose ses résultats à son niveau, puis reverse éventuellement des dividendes (imposés à nouveau !) Ça peut paraître délirant la première fois qu’on le comprend, mais ça permet souvent d’optimiser selon vos projets : patrimoine ou business, cercle familial ou investisseurs… À rapprocher des démarches pour choisir un auto entrepreneur ou sasu : la structure dit tout ! Société transparente ou translucide : quelles nuances ? Alors là… honnêtement, « translucide », je le vois surtout en blague entre fiscalistes. Mais en réalité, il existe des sociétés dites semi-transparentes : Transparente : la totalité du résultat passe à l’associé Opaque : la totalité est imposée à la société Semi-transparente : certaines parties du résultat passent à l’associé, pas tout Typiquement, dans certaines sociétés de personnes, on peut être imposé à l’IR pour certains flux et à l’IS pour d’autres. Mais en pratique, vous verrez très peu de montages « translucides » utilisés par des petites boîtes ou SCI. C’est franchement de la purée administrative, et j’aurais tendance à l’éviter vous aussi… Société transparente et SCI : quelles spécificités fiscales ? Ah, la SCI transparente ! Clairement, c’est la star du genre en France. On touche à l’immobilier, à la gestion familiale ou patrimoniale. Je pourrais écrire (et j’ai souvent écrit) des pages là-dessus. SCI (Société Civile Immobilière) : par défaut, transparente fiscalement. La SCI enregistre ses résultats, puis les répartit à chaque associé. Parfois, elle peut opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) : bascule alors dans la catégorie opaque. Spécificités : possibilité de transmettre des parts facilement, répartition des revenus, partage des déficits… Sincèrement, pour quelqu’un qui veut gérer un petit parc immobilier avec des proches, c’est le paradis ! Mais attention : si vous tombez dans la SCI détenue par une société à l’IS, plus aucun droit à la transparence. C’est verrouillé. Société transparente : SCI transparente en pratique Laissez-moi vous raconter : j’ai accompagné un client qui, avec sa compagne, détenait une SCI transparente. Ils louaient deux appartements. Revenus : 14 000 € par an, charges déduites. Chacun détient 50 %. Sur leur feuille d’impôt, 7 000 € de loyers venaient s’ajouter à leurs autres revenus. Alors, oui, c’est « transparent », mais aussi parfois… douloureux ! Si vous êtes déjà en tranche à 30%, attention à la facture fiscale. À l’inverse, avec un patrimoine qui dégage un déficit (travaux, intérêts d’emprunt), vous pouvez « aspirer » le déficit dans votre propre déclaration. C’est là le principal atout de la SCI transparente pour l’optimisation des revenus fonciers – c’est d’ailleurs souvent au cœur du concept de retours sur investissement. J’insiste : la SCI transparente, c’est un outil. À manier avec stratégie ! SCI transparente SCI opaque Revenus de la SCI directement imposés chez l’associé (IR) SCI paie l’IS, puis dividendes imposés chez l’associé Déficits imputables sur le revenu global Déficits restent en SCI Dividendes non taxés chez l’associé Dividendes taxés à la flat tax/IR Société transparente
Boni de liquidation calcul : tout savoir pour bien comprendre et appliquer la méthode

📝 En bref : le boni de liquidation calcul en 5 points clés Le boni de liquidation représente le surplus dégagé après la liquidation d’une société, une fois tous les créanciers remboursés. Formule clé : résultat de liquidation = capitaux propres – capital social. Fiscalité : ce boni est généralement soumis au droit de partage de 2,5% et à des prélèvements spécifiques. Répartition : il se distribue aux associés selon leur quote-part de capital, parfois différemment pour les sociétés unipersonnelles (SASU, EURL). Optimisation : plusieurs astuces existent pour limiter la fiscalité liée au boni de liquidation (anticipation, stratégie, etc.). Si vous arrivez ici, c’est que, tout comme moi la première fois, vous vous demandez vraaaaiment comment ce fameux boni de liquidation calcul fonctionne dans la vraie vie d’entrepreneur… Croyez-moi, derrière les grands mots et les formules, il y a surtout des enjeux concrets : combien va rester dans votre poche en fermant la boîte, et comment bien gérer tout ça côté papiers ! On va voir ça sous tous les angles. D’ailleurs, si vous souhaitez approfondir d’autres notions de gestion comme le bilan simplifié comptabilité ou le 123 paie, je vous recommande mes articles dédiés qui donnent des outils pratiques au quotidien. Qu’est-ce que le boni de liquidation ? Définitions et notions clés Vous connaissez cet instant bizarre où on ferme une société ? On rembourse tout le monde, puis soudain, il reste un peu d’argent dans la caisse : c’est le fameux boni de liquidation. À la base, c’est simple : ce surplus, c’est ce qu’il reste à partager entre les associés après que tout a été payé (créanciers, impôts, dettes…). Pour moi, la première fois que j’ai vu ce terme en assemblée, j’ai cru que c’était une combine… Mais non, c’est tout à fait légal, réglementé, et même très codifié ! Somme attribuée une fois la société dissoute et ses dettes soldées Indemnise les associés au-delà de leurs apports Exige souvent, en contrepartie, le paiement de taxes spécifiques (attention à la douloureuse…) Pas besoin d’avoir fait Sciences Po : le boni, ça vous concerne si vous êtes associé, actionnaire, même solo dans une SASU ou une EURL. Si, par exemple, vous fermez une SCI avec un petit matelas, le boni devient tout de suite un sujet ! Différence entre boni et mali de liquidation Deux faces d’une même pièce ! Le boni, c’est le “plus” ; le mali, c’est le “moins”. Si, après avoir tout payé, il reste des sous : boni ! Si, au contraire, l’entreprise finit en négatif (plus d’actifs, mais trop de dettes), on parle alors de mali de liquidation. Le boni se partage, le mali ne laisse que des pertes (et pas de fête…). C’est aussi simple et brutal que ça. Pour être concret : Boni de liquidation = capitaux propres > capital social (il reste de la valeur à rendre !) Mali de liquidation = capitaux propres < capital social (on rembourse moins, ou rien) Autrement dit : en boni, chacun touche un morceau. En mali… c’est parfois la soupe à la grimace, surtout si vous aviez misé gros. La méthode précise pour effectuer un boni de liquidation calcul Ici, je rentre vraiment dans le dur. J’ai fait et vu plusieurs liquidations, y compris quelques cas (très) tordus. Le calcul clé, il tient souvent à une équation… mais bon, la réalité réserve toujours des surprises. J’en parle juste en-dessous ! Boni de liquidation calcul : formule et explications Impossible d’éviter le passage “maths” : Boni de liquidation calcul = capitaux propres au jour de la liquidation – montant du capital social remis. Mais concrètement, ça donne quoi ? Calculer tous les actifs restants (argent, matériels, stocks…). Régler la totalité des dettes (fisc, fournisseurs, etc.). Rembourser le capital social aux associés (ce qu’ils ont mis dans la société). Partager l’excédent (le boni) à proportion. Pas bien clair ? Voilà un mini-tableau synthétique pour mieux visualiser : Élément Montant (exemple) Capitaux propres lors de la liquidation 70 000 € Capital social à rembourser 50 000 € Boni de liquidation 20 000 € En vrai, on prend parfois trop à la légère ce “petit calcul de clerc de notaire”… alors que, franchement, tout se joue là ! Pour un rappel sur le calcul du point mort d’une activité – c’est une logique hyper voisine – faites un saut sur calculer le point mort. Boni de liquidation calcul dans les cas spécifiques (SCI, SARL, SASU…) Dans la vraie vie, beaucoup me demandent si c’est la même méthode pour une SARL, une SCI, ou une SASU… Oui, la structure globale du calcul ne change pas, mais il faut veiller à quelques nuances clés : SASU / EURL : pas de répartition à faire, puisque l’associé unique prend tout ! Mais l’imposition reste identique. SCI : attention aux apports en nature/liquidités, et aux spécificités du régime fiscal (IR ou IS). SARL : répartition du boni selon la part du capital de chaque associé, ni plus ni moins. D’un point de vue expérience, pour avoir accompagné un copain sur sa SCI liquidée en 2022, le piège consiste souvent à zapper les vieux apports en compte courant qui traînent… Un oubli et le calcul est faussé ! Boni de liquidation calcul : comment se répartit le boni de liquidation entre les associés ? C’est probablement la question la plus délicate à gérer humainement… Car, soyons honnête : “à qui revient quoi”, c’est là que les conflits surgissent si les statuts n’étaient pas hyper carrés ! Rôle des parts sociales dans la répartition du boni de liquidation calcul La règle de base : chacun touche une part du boni proportionnelle au nombre de parts sociales qu’il détient. Exemple express : dans une SARL à 4 associés, si l’un détient 25 % des parts, il récupérera 25 % du boni. En théorie, c’est limpide… Sauf que, dans la pratique, tout se complique avec les conventions, les apports mixtes, les sous-criptions différées, etc. Perso, j’ai vu des associés oublier une clause et… perdre une bonne petite somme, je vous le garantis. Boni de liquidation calcul dans les sociétés
Comprendre le bodacc : le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Vous avez tapé « bodacc » et rien que de lire cet acronyme, vous sentez la paperasse, le juridique, la transparence… ou, franchement, vous ne savez pas trop par quel bout le prendre ? Je me suis retrouvé face à ces annonces officielles un paquet de fois… et oui, la première fois, je me suis perdu dans les méandres des annonces légales. Mais, là, je vous propose d’y voir beaucoup plus clair (et sans tourner autour du pot). Avant d’aller plus loin, une image : imaginez le bodacc comme la grande vitrine transparente de tout ce qui bouge dans la vie des entreprises françaises. Pas de magie, juste de la loi, de l’info, et un sacré paquet d’enjeux pratiques ! Allez, je rentre vite dans le vif. 📝 En bref – bodacc, c’est quoi ? Bulletin officiel d’annonces légales des entreprises françaises Publie les créations, modifications, ventes, cessions, procédures collectives (liquidations, sauvegardes, etc.) Consultation gratuite en ligne, sur le site officiel ou via API Outil essentiel pour notaires, entrepreneurs, curieux ou justiciables Garantie de la transparence économique en France Voilà. Vous savez déjà l’essentiel : le bodacc, c’est la porte d’entrée vers l’info officielle sur la vie des entreprises, que vous soyez notaire qui planche sur une succession ou entrepreneur sur les dents. Si vous cherchez des outils pour analyser un secteur ou comprendre le mapping concurrentiel, ou que les arcanes du comité d’entreprise vous intéressent, ces articles sur le site pourraient aussi vous parler. Bon, on attaque le cœur du sujet. Qu’est-ce que le bodacc et quel est son rôle ? Le fichier bodacc : définition et mission Alors, c’est quoi le fichier bodacc exactement ? Parfois on s’y perd entre annonces officielles, obligations, mentions légales… Je vais aller droit au but. Le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – le BODACC, donc – c’est LA publication légale qui recense toutes les grandes lignes de la vie des sociétés françaises. Création d’une boîte, mise en vente d’un commerce, liquidation judiciaire d’une PME, cession d’un fonds, modification de dirigeants… Là, tout est archivé, noir sur blanc. La mission du bodacc, c’est de garantir la transparence économique et juridique, point. Il s’agit d’un fichier (oui, on parle bien d’un « fichier bodacc ») tenu et mis à jour par l’État. Pas d’arrangement possible : si une annonce concerne une entreprise, elle finit ici. Ça a l’air formel mais, derrière, ça protège tous les acteurs économiques, et là-dessus, je vous l’assure, chaque détail peut compter (un changement de gérant non publié, et c’est la pagaille derrière un contrat !). Quels types d’annonces publie le bodacc ? Créations d’entreprises: ouverture, constitution de sociétés ou d’associations Modifications statutaires: changements de dirigeants, d’adresse, d’objet social… Cessions/ventes: vente de fonds de commerce, cessions d’actifs importants Procédures collectives: publicité des ouvertures de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire Dissolutions et radiations: fermeture définitive, liquidation amiable Honnêtement, chaque annonce publiée par le bodacc est un signal officiel – c’est là où vous pouvez vérifier qu’une entreprise existe vraiment, ou que la liquidation judiciaire a été prononcée. Pour ceux qui font de la prospection, de la surveillance concurrentielle ou juste veulent éviter de se faire avoir par une boîte en liquidation, c’est une mine… Un peu comme consulter les indices clés pour prendre une décision (je pense aux analyses style calcul indice de vente, qui peuvent vraiment vous aiguiller). Comment consulter le bodacc gratuitement et facilement ? Accéder aux annonces bodacc via le site officiel Rendez-vous sur bodacc.fr – c’est LA source Moteur de recherche simple : entrez le nom, SIREN, ou événement Téléchargement possible en PDF, accès filtré par thématiques Consultation toujours gratuite, aucune inscription nécessaire pour les annonces Petit conseil d’ami : si vous n’avez jamais mis les pieds sur bodacc.fr, la recherche peut d’abord sembler austère, mais en deux clics vous tombez sur l’annonce recherchée. Si vous êtes du genre à fouiller, n’oubliez pas le filtre par type d’annonce, ou la recherche par SIREN (le sésame des juristes !). Et franchement, tout ce qui est PDF, c’est top pour archiver ou envoyer à un tiers (on se retrouve souvent à transférer ça à un cabinet d’avocats, surtout après l’annonce d’une procédure collective). D’ailleurs, pour tout ce qui concerne l’accès aux documents contractuels, le caractère non contractuel des photos dans les annonces commerciales, c’est aussi à connaître. Utiliser l’API bodacc pour la consultation automatisée API ouverte sur bodacc-datadila.opendatasoft.com Idéale pour les professionnels (comptables, juristes, analystes de données…) Récupération en masse des annonces légales bodacc Formats variés : JSON, CSV, parfois XML, pour intégrer dans vos outils métiers Là, je parle franchement aux technophiles et data driven : ce service permet d’obtenir toutes les annonces sans cliquer sur chaque fiche. Vous pouvez programmer des alertes automatiques sur certaines entreprises ou procédures collectives – c’est royal. Bien sûr, il faut bidouiller un peu l’API (rien de sorcier si on a déjà touché à Excel ou Google Data Studio, mais bon, c’est une autre histoire). D’ailleurs, pour aller plus loin sur l’optimisation de votre gestion documentaire et automatiser ce genre de tâches, le sujet du logiciel Amberscript vaut le détour pour les pros qui veulent gagner du temps. Les annonces de liquidation judiciaire et leur diffusion sur bodacc Pourquoi le bodacc publie les procédures collectives ? Informer les créanciers sur l’ouverture d’une procédure Permettre la déclaration de créances ou d’observations Garantir la transparence pour les partenaires, fournisseurs, clients Avertir le grand public lors de cessions/cessations d’activité Voilà une question pas si simple. Quand une entreprise passe en liquidation ou en redressement, l’annonce bodacc en fait foi : c’est le top départ pour tous les créanciers pour se manifester. En tant que professionnel, je vous le dis, c’est souvent ce qui lance le branle-bas de combat en interne (petit flash-back : un client dont j’attendais un règlement est passé bien discrètement en liquidation… heureusement que j’avais mis une alerte sur le bodacc !). Bref, sans cette publication, il y aurait trop d’abus ou de pertes pour les parties prenantes, d’où sa centralité dans la procédure. Où trouver la liste des entreprises en liquidation sur bodacc ? Sur le site officiel bodacc.fr : filtre « liquidation judiciaire »
